Accueil > Amphi ClassEdu > La communication en classe : onze dilemmes
La communication en classe : onze dilemmes
Philippe Perrenoud
jeudi 24 juin 2021, par
Chacun des dilemmes proposés est construit à partir d’un enjeu autour 1. de la prise de parole et du silence ; 2. de la justice ; 3. de la norme langagière ; 4. du mensonge ; 5. de la sphère privée ; 6. du conflit ; 7. du pouvoir pédagogique ; 8. du bavardage ; 9. de l’erreur, de la rigueur et de l’objectivité ; 10. de l’efficacité et du temps didactique ; 11. de la métacommunication et du sens.
Ce découpage est partiellement arbitraire et l’ordre est sans importance. Il s’agit surtout d’explorer diverses facettes de la communication, en montrant pour chacune d’elle la difficulté de trouver et de conserver une ligne de conduite parfaitement cohérente, sauf à renoncer à l’une des dimensions de l’action pédagogique.
Chaque dilemme est résumé dans un encadré.
1. Autour de la prise de parole et du silence
Sous peine d’anarchie, il faut, dans une classe, " demander la parole ", pour permettre un échange ordonné, mais aussi pour reconnaître l’enseignant comme chef d’orchestre des échanges. C’est pourquoi le bavardage dans le réseau clandestin de communication et les prises de paroles sauvages dans le réseau officiel (Sirota, 1988) sont doublement proscrits : 1. ils perturbent le fonctionnement ; 2. ils effritent l’autorité du maître.
Envers de la parole, à l’école, " le silence est d’or ". Il est réputé nécessaire pour écouter et travailler. Ce qui n’empêche pas le maître de le rompre à sa guise pour compléter ses consignes, intervenir dans le débat ou réprimander un élève. Lorsqu’il veut " entendre voler une mouche ", la parole des élèves le dérange. Lorsqu’au contraire, il sollicite leur participation, leur silence lui pèse, et devient intolérable s’il l’interprète comme un signe de résistance, d’indifférence, de dérision, de manque d’intérêt.
L’enseignant prétend avoir le privilège à la fois d’imposer le silence et de le rompre, de dire qui doit parler et qui doit se taire, quand et pourquoi. Cependant, s’il en abuse, ses élèves oublieront ce qu’ils voulaient dire et se désintéresseront d’une conversation qui ne laisse aucune place à l’improvisation, au désordre, à l’initiative, aux personnes. Ils feront au mieux les réponses convenues, celles que le maître attend pour faire progresser son cours, sans plaisir, sans implication, sans âme, donc souvent, sans apprentissage.
Premier dilemme
Comment contrôler la prise de parole sans stériliser
les échanges, tuer la spontanéité, le plaisir ?
2. Autour de la justice
Dans une classe, la parole n’est pas seulement un droit des personnes, plus ou moins réglementé selon la tâche à accomplir. C’est ou ce devrait être une occasion d’apprendre, d’argumenter, de faire part de ses questions et de ses doutes, de s’essayer à formuler une observation, une hypothèse, un raisonnement, de prendre une part active à la construction de situations-problèmes ou à leur résolution. Or cet idéal se heurte à plusieurs obstacles majeurs :
ce sont en général les élèves qui ont le moins de difficulté qui monopolisent la parole ; or le maître ne peut systématiquement les réduire au silence sans les blesser, les décourager, les dresser contre lui ;
les élèves qui gagneraient le plus à parler n’osent pas, parce qu’ils n’ont pas confiance en eux, ne se sentent pas écoutés ; ils ressentent toute insistance comme une violence, et le maître prend aussi le risque de les placer dans des situations difficiles, si leurs camarades se moquent d’eux ou ne prêtent guère d’attention à leurs propos ;
le maître lui-même a besoin de partenaires " à la hauteur " pour progresser dans sa " leçon " ou faire fonctionner une activité ou un projet ; paradoxalement, plus une activité collective est ambitieuse, plus elle dépend des élèves les plus à l’aise dans la communication.
Second dilemme
Comment ménager une certaine équité sans blesser les uns et faire violence aux autres, sans interférer avec les règles du jeu social ?
3. Autour de la norme langagière
La correction de la forme prend souvent le pas sur l’efficacité du message. L’important n’est pas d’être compris, mais de respecter les formes et les normes (Perrenoud, 1988 a). L’expérience de beaucoup d’élèves est d’être interrompus pour être repris sur la forme (" On ne dit pas… ") et de perdre le fil de leur propos ou de ne pas voir le sens de continuer.
Il arrive même qu’on réprimande un élève pour avoir dit quelque chose de juste trop tôt, coupant son effet au maître, qui voulait ménager le suspense, ou pour avoir anticipé sur le programme de l’année suivante, sur ce qu’il n’est pas censé le savoir encore.
Cependant, un enseignant qui " laisserait tout passer " se trouverait en butte aux critiques des parents, voire de l’inspecteur, de certains collègues, de certains élèves : incarner la norme est une des attentes traditionnelles à l’égard de l’école. L’enseignant n’agit pas en fonction de sa propre tolérance, mais en tant que délégué d’une " société " qui lui reprochera facilement son laxisme.
Par ailleurs, un rapport normatif à la culture, à la connaissance et à la langue est constitutif de l’identité d’une partie des enseignants. Il y a des choses qu’on " ne peut pas laisser dire ". Enfin, inculquer le respect de la norme fait partie des objectifs de l’enseignement, du cahier des charges. Il n’est donc pas facile de savoir quand le renvoi à la norme est formateur et quand il détourne d’un apprentissage plus important.
Troisième dilemme
Comment respecter les formes de la communication et de la langue sans réduire les élèves au silence ou aux banalités prudentes ?
4. Autour du mensonge
La transparence est une valeur éducative majeure. Le mensonge &emdash; voire l’affabulation &emdash; sont pris comme des signes de perversité ou d’immaturité. On souhaiterait, pour son bien, pouvoir lire un enfant " à livre ouvert " (Repusseau, 1978). Les adultes n’acceptent pas que les enfants ou les adolescents soient des acteurs " comme les autres ", ayant de bonnes raisons de ne pas tout dire ou d’enjoliver les choses, de ruser, de retenir de l’information à des fins tactiques (Perrenoud, 1988 b). Or, comme le disait un Père Jésuite, " Dieu a donné la parole à l’homme pour qu’il dissimule sa pensée ". Dans un espace aussi exigu que la classe, il est difficile de cacher quoi que ce soit, en particulier au maître, qui a un pouvoir d’inquisition sans pareil. C’est ce que j’ai appelé la Glasnost pédagogique (Perrenoud, 1991 b), variante du panoptique analysé par Foucault (1975). Si l’on enjoint en plus à l’élève de " dire tout ce qu’il pense " parce que " c’est pour son bien ", on le prive d’une forme d’identité, d’autonomie, d’existence comme sujet. Lorsqu’on ne peut cacher ni son comportement, ni le contenu de son pupitre, de son cartable ou de son cahier, la seule ressource qui reste est d’expliquer les choses à sa façon, de se trouver des excuses : " Je n’avais pas compris, je n’ai pas eu le temps, on ne m’avait pas dit, je croyais… " Demander à quelqu’un d’étaler toutes ses faiblesses, de dévoiler ses erreurs ou ses doutes, ses paresses ou ses contradictions, c’est lui demander de perdre la face et de prendre des risques (réels ou fantasmés) face à quelqu’un qui, en fin de compte, l’évalue et décide de sa carrière.
Même en reconnaissant le besoin d’une distance tactique entre le discours et la pensée (ou les émotions, ou certains actes), un enseignant se trouve mal pris :
parce qu’il lui est très difficile de ne pas prendre " contre lui " tout accroc à la transparence ; l’éducateur veut être aimé, il veut jouir de la confiance des enfants et des adolescents qu’on lui confie, il supporte difficilement qu’on le traite comme un " adversaire ", quelqu’un avec qui on entretient un rapport stratégique ;
parce que son rôle et son rêve ne le poussent pas en général à former des jeunes gens rusés, habiles, mais au contraire sincères, honnêtes, voire naïfs.
Quatrième dilemme
Comment valoriser l’expression ouverte et honnête des idées et des sentiments sans dénier aux élèves le droit d’être des acteurs, donc parfois de dissimuler et d’enjoliver ?
5. Autour de la sphère privée
Dans la mesure où c’est " pour le bien de l’enfant " ou " par nécessité ", on entre souvent sans trop de ménagements dans sa sphère personnelle. Il n’apparaît pas scandaleux, dans une classe, d’intervenir dans une conversation privée, en demandant aux élèves d’en faire part à haute voix (" Ça nous intéresse, ce que vous dites "), d’intercepter un billet qui circule, de mettre un élève en demeure de dire ce qu’il pense, de le pousser dans ses retranchements, d’interrompre sa rêverie (" Alors, encore dans la lune ? "). L’élève n’a pas systématiquement droit à son for (son fort ?) intérieur. Sa famille n’est pas mieux protégée : autour des maladies de l’élève ou de ses moments de fatigue, de ses absences physiques ou mentales, de sa propreté, de l’état de ses vêtements ou de ses outils de travail, l’enseignant fait des incursions dans sa vie hors de l’école : " Tu a encore regardé la télévision jusqu’à des heures impossible, je me demande quelle vie tu mènes ", " Tu es d’une saleté… est-ce qu’on se lave chez toi ? ", " Encore en retard, tes parents ne travaillent pas ? "
Les pédagogies actives posent le problème par un autre biais : plus on fait " entrer la vie dans l’école ", plus on travaille à partir du vécu de chacun, plus on engage les élèves dans des activités qui ont du sens, dans des projets concrets, moins on leur permet d’établir une frontière étanche entre leur statut d’élèves et leur existence hors de l’école. Raconter, apporter des objets, solliciter ses parents pour un spectacle, une enquête, une vente, c’est raconter une partie de sa réalité, c’est brouiller les limites entre le privé et le public. Apprendre à argumenter sur des thèmes de la vie de tous les jours, comme le chômage, l’argent, le racisme, le logement, la drogue, la violence, la télévision, les loisirs, le travail, la consommation, c’est dévoiler des modes de vie, des valeurs, parfois des déviances ou des failles, c’est dire ce qu’on mange, ce qu’on regarde, ce qu’on fait, ce qu’on dit en famille (Perrenoud, 1987). Souvent, l’enseignant en apprend plus qu’il ne voudrait, parce que les enfants ne savent pas encore cacher leur vie aussi bien que les adultes.
Cinquième dilemme
Comment faire entrer la vie dans l’école sans attenter à la sphère intime des élèves et des familles ? Comment traiter l’élève comme une personne et l’impliquer dans des activités qui ont du sens pour lui sans l’exposer ?
6. Autour du conflit
À l’école, le conflit n’est pas vécu positivement. Même les enseignants qui croient au conflit sociocognitif en ont souvent une image aseptisée : ce doit être un conflit tranquille, sans passions, sans implication de la personne, sans vainqueur ni vaincu. Comme si les seuls désaccords intellectuels tolérables devaient exclure les partis pris, la violence verbale, la mauvaise foi, les enjeux de pouvoir, la compétition. La communication peut aider à régler les conflits. Mais en classe, souvent, on s’en sert d’abord pour les nier, les étouffer : " Tu n’as pas le droit de dire ces choses là ", " Tu n’as pas honte ? ", " Ne critique pas tout le temps ". La communication est associée à l’ordre, voire à l’harmonie plutôt qu’à la négociation et aux rapports de force.
On ne saurait davantage tomber dans l’excès inverse : l’école est un lieu protégé, on ne peut apprendre en adoptant constamment une attitude défensive, on ne pardonnerait pas à l’école de laisser éclore la violence, le racisme, le sexisme, les rapports de forces, fût-ce sur un plan purement verbal.
Sixième dilemme
Comment ne pas aseptiser la communication, la vider de toute référence à la vie et à ses contradictions, aux conflits sociaux, sans mettre les élèves et les enseignants en danger ?
7. Autour du pouvoir pédagogique
Alors que la conversation est fondamentale dans la vie humaine, en classe elle devient du bavardage dès lors qu’elle échappe au contrôle de l’enseignant. Il se sent le chef d’orchestre, l’initiateur, le garant des échanges, de leur contenu, de leur niveau, de leur correction, de leur durée, de leur progression vers un but. En classe &emdash; comme à l’église, à l’armée ou devant la justice &emdash; la communication est gouvernée par un acteur plus responsable et puissant que les autres, qui est à la fois joueur et arbitre. C’est donc lui qui fixe les règles du jeu. L’apprenant est au contraire censé jouer à l’intérieur de ces règles. La communication en classe est donc fondamentalement asymétrique, mais cette asymétrie apparaît dans l’ordre des choses, l’expression d’un pouvoir légitime. D’autant plus légitime qu’on ne le questionne pas, qu’on ne se demande pas de quel droit le maître " fait la classe ". C’est l’un des tabous de la communication pédagogique. Le maître s’abrite derrière son rôle institutionnel (" Vous savez bien que je n’ai pas le choix "), les élèves ne parlent qu’entre eux de leurs façons de se protéger de l’autorité, des exigences de l’institution ou du maître.
Alors que la communication est fondée sur des rapports de pouvoir et permet de les mettre en œuvre, on préfère en général censurer cet aspect des choses. Cette prudence n’est pas sans conséquence pour la formation, dans divers registres : ne pas analyser les phénomènes de pouvoir et d’autorité en classe et dans l’école, c’est renoncer à des " leçons de choses " qui seraient la meilleure forme d’instruction civique, ou d’éducation à la citoyenneté, comme on dit désormais ; les pédagogies institutionnelles l’avaient bien compris. C’est aussi ne pas aider à comprendre, voire à contester l’autorité de ceux qui savent, c’est construire un rapport révérencieux au savoir. C’est, enfin, ne pas préparer à se servir de la langue et de la pensée pour négocier à l’intérieur des organisations : négocier les conditions et les temps de travail, les règles, les objectifs, etc. (Perrenoud, 1991 a).
Septième dilemme
Comment ne pas euphémiser la part du pouvoir dans la communication sans mettre en cause l’autorité du maître ? Comment donner des outils d’analyse et de négociation sans en être la première cible ?
8. Autour du bavardage
L’idée que la communication relève d’un contrat (explicite ou implicite) n’est guère courante. Les conduites des élèves n’apparaissent pas objets de négociation, mais plutôt de rappels à l’ordre. La seule communication vraiment acceptable en classe est celle que l’enseignant organise, sur le sujet légitime dont il a choisi de parler et de faire parler. Tout le reste est du bruit. D’où une image de la " bonne communication " : centrée sur un thème, ordonnée, faisant avancer un débat ou une leçon, donc fonctionnelle et rigoureuse.
Or, ce type de conversation représente une part seulement des raisons qu’ont les êtres humains de communiquer. Les élèves ont un besoin impératif de se parler de nombre de choses étrangères à l’activité en cours ; ou de parler de cette activité sur le mode de la révolte, de la dérision, de la ruse. Le maître lutte contre ces dérives, pour maintenir ou faire revenir les élèves dans le sujet et dans le réseau officiel de communication. L’enseignant fonctionne donc comme le chien de berger qui ramène les moutons égarés dans le troupeau. C’est son rôle et pourtant, s’il le joue avec trop de rigueur, il prive ses élèves de liberté, d’émotion, de rire, autrement dit, d’oxygène. Il est vital d’avoir le droit, le temps de bavarder. C’est une source de sens, d’identité, de force. Les institutions carcérales le savent bien, qui interdisent toute communication entre les détenus. Pour briser l’individu, on l’empêche de parler à ses semblables, c’est une tactique vieille comme la répression. Plus banalement, un élève qui a sur le coeur une anecdote, une critique, un commentaire ironique, une question, n’est guère disponible pour apprendre.
Huitième dilemme
Comment impliquer les élèves dans le projet principal sans les priver du droit de bavarder ? Comment trouver l’équilibre entre le contrôle tatillon des propos et l’explosion des conversations particulières ?
9. Autour de l’erreur, de la rigueur et de l’objectivité
On va à l’école pour apprendre, autrement dit pour s’approprier, tant bien que mal, des savoirs et des savoir-faire reconnus comme légitimes, fondés, utiles, importants. Le rôle du maître est donc de proscrire l’erreur, d’éradiquer les représentations fausses, les prénotions, pour leur substituer la vérité scientifique (ou esthétique, ou morale) du moment. Or, on sait que cette " vérité instituée " est parfois une contrevérité : l’enseignement de la biologie et notamment de la génétique, dans certains États américains ou dans l’URSS de Staline, devait davantage à la religion ou à l’idéologie qu’à une science indépendante du pouvoir. Quant à l’histoire, à la littérature, à la philosophie, à la géographie, on sait qu’elles sont dans les États totalitaires &emdash; voire dans des sociétés plus démocratiques &emdash; un détour pour façonner une " juste " vision du monde.
Même lorsque les contenus de l’enseignement sont irréprochables quant à leur " objectivité ", on sait désormais, grâce aux travaux des didacticiens, que les savoirs se heurtent à des représentations préalables bien installées, qui viennent de l’expérience personnelle, de toutes sortes de schémas intuitifs, de la culture familiale, etc. Le professeur se trouve donc devant un choix difficile : s’il ne laisse pas s’exprimer les représentations des apprenants, il se bornera à leur juxtaposer des savoirs scolaires. Comme le montre Astolfi (1992), ces savoirs seront mobilisés en situation d’évaluation, devant des tâches canoniques. Mais devant un vrai problème, les représentations préalables et les théories naïves reprendront leurs droits, parce qu’elles fonctionnent, subjectivement, comme de véritables clés d’intelligibilité, alors que les savoirs scolaires ne sont pas des outils. Si le professeur, au contraire, donne de la place aux représentations des apprenants, il se trouve confronté à des " mondes subjectifs " divers, souvent cohérents et peut-être plus convaincants que la théorie scientifique. Comme il n’a ni le temps ni les moyens de les faire tous expliciter, pour les réfuter pas à pas avec les élèves, il court le risque de donner droit de cité à des théories fausses, parfois plus prégnantes et séduisantes que les concepts scientifiques. Comme l’écrit De Vecchi (1993) : Des représentations, oui, mais pour en faire quoi ?
Neuvième dilemme
Comment faire une place aux représentations des apprenants sans mettre en circulation des théories fausses et leur donner crédit ? Comment autoriser chacun à dire ce qu’il croit sans tomber dans le relativisme ou l’obscurantisme ? Comment travailler avec l’erreur sans la légitimer ?
10. Autour de l’efficacité et du temps didactique
À l’école, le temps est compté. Les didacticiens, lorsqu’ils analysent les séquences, montrent que l’enseignant organise souvent un pseudo dialogue qui lui permet d’avancer, de conduire les élèves là où il projetait d’arriver. Rien de plus facile : il suffit d’ignorer les interventions divergentes et de piloter les interventions utiles. À la limite, on retrouve ce que Brousseau a appelé " l’effet Topaze " : la question contient la réponse, la leçon devient un catéchisme, avec une répartition fictive de la parole, puisqu’il s’agit de dire un texte qui ne laisse guère de liberté.
À l’inverse, laisser s’exprimer librement les élèves, suivre toutes les pistes, prendre toutes les questions au sérieux, entendre tous les doutes, emprunter tous les chemins de traverse, ouvrir toutes les parenthèses, saisir toutes les occasions, c’est à coup sûr perdre le fil conducteur et se retrouver à la fin de la période très loin de son objectif, voire complètement perdu. Ce qui renforce la solitude de chacun et le sentiment d’impuissance du maître.
Dixième dilemme
Comment laisser un espace à la construction interactive des savoirs sans que la conversation aille " dans tous les sens " ? Comment ne pas canaliser complètement la communication didactique sans perdre pour autant tout fil conducteur ?
11. Autour de la métacommunication et du sens
En classe, on ne cesse de communiquer. Et on ne se prive pas de communiquer à propos de la communication. Mais il s’agit en général d’interventions normatives ou d’injonctions du maître, en regard desquelles les élèves répliquent, plus sourdement : " Pas aussi vite‘ " ou " Je n’y comprends rien ". Ces microrégulations ne relèvent pas d’une véritable métacommunication, d’une explicitation des règles du jeu et de leurs fondements, des rapports sociaux, des relations intersubjectives et des mécanismes institutionnels à l’œuvre dans la situation de classe. L’école se caractérise souvent par une fuite en avant. On n’y prend pas en général le temps de s’arrêter pour comprendre ce qu’on est en train de faire, pour construire du sens. Ou alors seulement lorsqu’on ne peut plus faire autrement, lorsque la crise menace ou éclate. Comment espérer alors, dans une situation tendue, instaurer un rapport analytique et relativement serein à la façon dont on fonctionne ensemble ? Le maître se contente alors d’une " reprise en main " ou d’un appel à la bonne volonté et à la raison des élèves. Il en va ainsi parce que font défaut des outils et une culture commune pour mettre à distance les finalités et les modalités du jeu scolaire, le sens des savoirs et du travail. D’où une forme d’acharnement pédagogique, de tendance à faire " plus du même ", faute de savoir changer de registre et repérer des dysfonctionnements de la communication. Comment s’étonner alors du peu de sens des savoirs scolaires (Charlot, 1993), du métier d’élève (Perrenoud, 1994 a) ?
Ceux qui s’engagent dans la voie de la métacommunication régulière et de l’explicitation du sens se heurtent cependant à d’importants problèmes. S’arrêter pour comprendre, cela prend du temps et surtout, cela oblige à d’immenses détours pour reconstruire, patiemment et collectivement, ce qui d’ordinaire " va de soi ", cela conduit à de périlleuses incursions dans l’imaginaire, les attentes, les valeurs, voire l’intimité des uns et des autres. Certes, cette démarche est en général profitable si on peut la conduire à son terme. Hélas, dans les conditions habituelles de l’enseignement de masse, surtout au second degré, il est rare d’avoir la possibilité de renégocier véritablement un contrat de communication. Ce sont en général les écoles alternatives ou les classes les mieux ancrées dans un courant de renouveau &emdash; mouvement Freinet, pédagogie institutionnelle &emdash; qui prennent le risque de donner au sens la priorité sur la progression dans le programme.
Onzième dilemme
Comment faire une place à la métacommunication et à la recherche de sens sans déstabiliser le groupe-classe et se trouver en porte-à-faux par rapport aux attentes de l’institution ?
Voir en ligne : Source et article complet
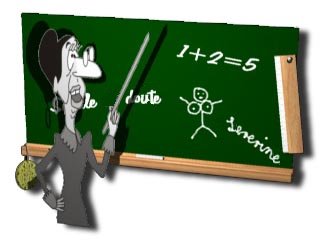 EDUDOCS ex classedu
EDUDOCS ex classedu